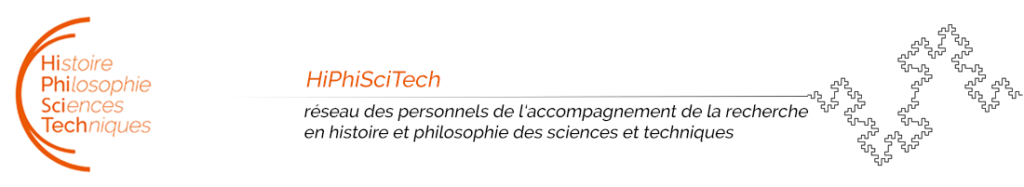|
Différent de l'auto-archivage réalisé par les auteurs, un dépôt sur ces plateformes fait l'objet d'une validation par une commission en relation avec l'établissement de soutenance et est pris en charge par une instance mandatée (Service Commun de la Documentation ; Direction de l'Appui à la Recherche ; Bibliothèque ; ...). |
DUMAS
-> Lien vers DUMASPlateforme de "Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance" Derniers mémoires recensés
L’objet de ce travail de recherches est de s’interroger sur l’influence de la religion protestante sur le développement des idées entre le XVIe et le XVIIIe siècle en Europe du Nord en étudiant notamment les relations entre le mouvement des Lumières et le christianisme. Dans un premier temps, ce travail s’intéressera à l’histoire du protestantisme, et essayera de montrer l’existence d’un lien entre la manière de penser des protestants et le rationalisme. Le catholicisme et la position de l’Église catholique vis-à-vis de l’effervescence intellectuelle et du progrès scientifique aura également une grande place dans cette étude. Bien que le progrès scientifique et culturel devînt de plus en plus gênant pour l’Église, il sera rappelé que certains catholiques jouèrent bel et bien un rôle dans le développement des idées de l’époque. Enfin, l’objectif sera de comprendre dans quelles mesures l’héritage des conflits religieux et les théories du XVIIIe siècle sur la religion et sur la tolérance religieuse menèrent à la déchristianisation puis à la laïcisation des pays européens.
Le mémoire considère un groupe de travail oeuvrant collectivement à la fabrication d'une pirogue : au-delà de l'activité technique et de la chaîne opératoire, il présente l'organisation du groupe (par encastrement du psychologique dans le social et le physique) ainsi qu'une vision d'ensemble des modes de production scientifiques. Le terrain a été réalisé en Guyane française, dans l'ethnie Djuka.
Après avoir été effrayé à l’idée de voyager par plaisir en raison de la connotation guerrière de cette dernière mais également d’une peur des reliefs naturels, une nouvelle perception renverse à la fin du XVIe siècle cette pensée. La conception utilitaire du voyage prend l'ascendant au cours du siècle suivant, avec la possibilité d'apprendre et de se forger une culture personnelle jugée essentielle aux nobles de cette époque. Cette conception évolue à nouveau grâce à l'influence des Lumières et de nombreuses découvertes scientifiques ou philosophiques du XVIIIe siècle. La pratique voyageuse est maintenant comprise comme un moyen de connaître la terre, de partager les savoirs pour une plus grande égalité. Dans ce contexte, les scientifiques sont devenues des acteurs centraux, notamment en se rendant directement sur les lieux à expertiser. Ainsi, en plus d'une large publication d'imprimés de relation de voyage fait par des nobles en mission diplomatique ou dans la réalisation de leurs Grands Tours, se développent en parallèle des mémoires scientifiques tirés de leurs voyages. Dans la même période, un nouvel acteur dans le chaînon de l'imprimerie vient bouleverser l'ordre établi au siècle précédent, les périodiques. C'est avec ce nouveau support que les savants-voyageurs ont diffusé non seulement des extraits de leurs mémoires mais également des lettres, des synthèses et des questionnements portants sur les avancées scientifiques. Dans ce microcosme où vivent savants et acteurs de l'impression, de nombreux d’échanges et interactions s’étiolent, tels que des demandes d'instructions spécifiques ou d'aide particulière pour récupérer divers échantillons provenant d'une région lointaine. Cet ensemble se représente également à travers le carnet, un outil essentiel à la sauvegarde des pensées du voyageur qui le suit en toutes circonstances au cours de ses trajets. C'est avec cette source que ce mémoire se propose de retracer la méthodologie d'un savant-voyageur au tournant du XVIIIe siècle en la personne du chevalier Déodat de Dolomieu. Au travers de ses carnets se dévoile les traces de sa pensée savante et des évolutions de cette dernière au cours de ses pérégrinations, permettant la reconstruction d'une méthodologie propre à ce dernier. De même, elle permet la sauvegarde des humeurs de son propriétaire au cours de ses trajets mettant en lumière sa perception de la pratique voyageuse. Enfin, ce même objet se révèle être l'outil le plus essentiel à la propre compréhension de sa conception aux yeux de son propriétaire, ainsi que de pouvoir distinguer si cela est réellement nécessaire les propriétés entre une relation de voyages pour son plaisir et celui d'une relation savante faite pour autrui.
Notre projet de mémoire, ci-dessous développé, est le suivant : comment étudier la notion d'émergence dans le cadre de la métaphysique anglo-saxonne contemporaine ? Pour répondre à cette question, notre réflexion partira du système ontologique particulier, à savoir le "carré ontologique", d'inspiration aristotélicienne et repris par un auteur contemporain, E.J. Lowe. Dans ce système, les catégories ontologique d'"objet", de "phénomène", de "propriété" et de "condition" sont analysées comme étant fondamentales, irréductibles et suffisantes pour décrire tout le contenu de la réalité. Nous nous sommes limités cette année à la présentation de ce système, espérant par la suite pouvoir le développer dans le sens d'un physicalisme non réductif. Notre thèse finale sera alors la suivante : il est possible que de nouvelles conditions émergent.
Nous proposons à travers ce travail de regarder la pensée philosophique comme étant essentiellement liée au phénomène d'ἀνάμνησις, c'est-à-dire au ressouvenir ou à l'anamnèse. Nous cherchons à repenser le propre du philosopher. Dans cette optique, philosopher signifie "se ressouvenir". Pourtant, l'anamnèse n'a pas affaire à la mémoire et aux souvenirs. Elle est expérience, à travers laquelle adviennent une vérité et un savoir. Notre point de départ se trouve dans une évidence de la pensée philosophique : la pensée a une histoire et s'enracine dans une tradition. Tout ce qu'on met devant la pensée, tout ce que la pensée prend comme tâche a un lien avec ce qui a été pensé auparavant ou fait référence à ce qui a été, qu'on l'admette ou non. Nous identifions, cachée sous la forme de cette évidence, une tendance de la pensée philosophique qui n'a pas été mise en question ou explicitée. Ainsi, philosopher c'est dans un certain sens se retourner vers le passé afin de le reprendre sous un jour nouveau. Ce point de départ trouve sa confirmation philosophique à travers une analyse "historique" : l'anamnèse chez Platon et Gadamer. C'est à travers cette façon de mettre à l'œuvre ce que l'évidence nous a dévoilé qu'on découvre que l'anamnèse décrit la recherche et la découverte de type philosophique. Pour Platon, l'άνάμνησις représente moins une actualisation d'un savoir tout fait, inné et latent, qu'une manière de reprendre quelque chose de "su" sous un jour nouveau. C'est donc ce mouvement "rétrospectif" qui rend possible le savoir et la vérité pour la pensée philosophique. Selon Gadamer, l'άνάμνησις platonicienne s'apparente à une re-connaissance. Ces deux analyses dévoilent une certaine "structure" que possède l'anamnèse, un certain mode d'être : elle se définit par le "re-". Il s'agit d'un re-vivre, re-connaître, re-conquérir, re-voir "à distance" la réalité. Ceci renvoie à l'idée de "voir" les choses "dans une autre lumière", ou faire une nouvelle expérience des choses qui apporterait un surcroit de connaissance. Le "re-" de l'anamnèse désigne le fait de re-faire une "expérience". L'anamnèse représente une expérience du philosopher. Philosopher et parvenir à un savoir signifie, dans ce sens, faire l'expérience de l'expérience.
|
TEL
-> Lien vers TELServeur de "Thèses en Ligne" et HDR Dernières thèses ou HDR recensées
Cette thèse a pour objet de mettre en lumière l'évolution de l'exploration scientifique durant le XIXème siècle en France. Pour cela, elle s'appuie à la fois sur l'histoire des sciences, l'histoire coloniale et l'histoire culturelle et des mentalités. Le parcours d'Alfred Grandidier se révèle caractéristique d'une époque charnière au cours de laquelle l'héritage de la science des Lumières est encore tangible tandis que sont déjà à l'œuvre les principes de la science coloniale qui s'épanouira dans l'Entre-deux-guerres. L'étude de l'itinéraire scientifique d'Alfred Grandidier, avec une nécessaire prise de recul, est également enrichissante du point de vue de l'expérience individuelle : en effet il s'agit d'analyser le processus de construction de la carrière scientifique et le cheminement personnel d'Alfred Grandidier, de sa formation durant l'enfance jusqu'à l'héritage intellectuel qu'il a légué. Cette thèse insiste sur les aspects matériels et quotidiens des voyages et des recherches de terrain, sans oublier l'implication du scientifique dans une multitude de réseaux ainsi que la construction de sa propre image.
Il est bien connu que la fiction, alors qu'elle est distincte de la réalité, entretient avec elle des similitudes importantes. Quant aux contrefactuels, leur rapport à la réalité est lui aussi double : ils renvoient, certes, à des situations irréelles, mais aux situations irréelles les plus similaires µa la réalité. Cette perspective dominante repose cependant sur la notion de similitude, laquelle est non seulement évasive, mais variable. Une analyse plus poussée du rapport entre la fiction et la réalité d'une part, et entre les contrefactuels et la réalité d'autre part, est-elle possible ? Ce travail offre un cadre conceptuel qui permet une approche approfondie de ces rapports, en mettant l'accent sur leur dynamique. En développant, d'abord dans le cas de la psychologie de la fiction, ensuite dans le cas des contrefactuels, une représentation fine de l'état de ce rapport à un instant particulier, et une théorie de son changement, on se donne des outils pour comprendre non seulement les détails du rapport entre la fiction (respectivement les contrefactuels) et la réalité à un moment donné, mais également le développement antérieur qui a mené à la situation où ce rapport, avec ces propriétés, est à l'oeuvre.
L’enquête est consacrée aux transformations des pratiques du jazz en France au vingtième siècle. Elle offre aussi, par le prisme du jazz, des éclairages sociologiques sur l’évolution des loisirs culturels, plus particulièrement sur celle de la culture lettrée, sa place sociale et la pluralité de ses formes. Ces transformations sont appréhendées à travers l’étude des catégories de perception et d’évaluation du jazz qui conditionnent la fabrication collective des expériences musicales et les diverses gratifications qu’elle peut occasionner – félicité esthétique, profits de vente, capital symbolique, etc. A la croisée de la sociologie de la culture, de l’anthropologie de la performance, de la socio-économie et de l’histoire culturelles, il s’agit par là de mieux saisir l’activité, rarement étudiée, des intermédiaires culturels (programmateurs, producteurs, éditeurs, impresarios, journalistes) dans leurs rapports conjoints avec les artistes et les publics. Cette sociologie de la « production de la réception » repose sur l’hypothèse que l’ensemble des secteurs culturels est placé en situation d’incertitude collective sur la valeur des œuvres et des artistes. Le moment de la réception publique des œuvres, et les catégories de perception et d’évaluation qui le conditionnent, apparaissent dès lors comme le « lieu » névralgique où les attentes et les ressources de tous les participants à la production continuée des mondes culturels doivent se déployer, se coordonner et occasionner les diverses rétributions recherchées. On peut ainsi décrire les activités comme régulées, chacune à leur façon, par la tentative d’anticiper, d’orienter et de capter les effets de la réception via les catégories de perception et d’évaluation que prescrivent les intermédiaires. Ces catégories sont observées non seulement dans leur état dispositionnel, sous la forme de schèmes classificatoires et d’habiletés corporelles partagés (des formes d’expérience), mais aussi dans leur état objectivé, sous la forme de structures situationnelles stabilisées (des dispositifs d’appréciation). L’enquête sur les catégories (dans la lignée, toutes proportions gardées, des Durkheim, Mauss, Bourdieu et Boltanski) est ainsi articulée aux réélaborations pragmatistes de la phénoménologie de l’expérience, en centrant l’analyse sur les actions performatives des intermédiaires, appréhendées à travers leurs techniques – soit les formes d’expérience qu’ils construisent et les dispositifs d’appréciation qu’ils fabriquent pour s’assurer de la réappropriation des premières. La notion de formes d’expérience propose une conception doublement temporalisée des cadres de l’expérience selon Erving Goffman (1991) : au plan de l’historisation des catégories d’action, dont l’histoire sociale est restituée, et au plan de la processualisation de l’ordre interactionnel, qui organise des cours d’action séquencés et orientés dont les dynamiques dépassent la simple somme des actions individuelles. Cette « processualisation » de la notion s’appuie sur l’approche pragmatiste de l’action par John Dewey (1980 [1934]), qu’il appréhende comme le « tout contextuel » formé par la dynamique structurée du commerce entre les individus et leur environnement, et sur l’approche phénoménologique de l’expérience musicale par Alfred Schütz (1964), qu’il définit comme une mise en phase (mutual tuning-in) des expériences temporelles des musiciens et des auditeurs par l’intermédiaire de la structure processuelle du « flux des sons audibles ». La notion de dispositif d’appréciation définit quant à elle des arrangements matériels et organisationnels (jazz-club, salle de concert, local associatif, festival…) qui objectivent les catégories en aménageant des épreuves destinées à réguler la coordination des forces mises en jeu. Construite à partir des usages que font Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991) et Michel Callon et Bruno Latour (2005 [1989]) du « dispositif » foucaldien (1994 [1976], p. 101-135), elle est prolongée pour traiter des épreuves de confrontation non pas seulement entre des ordres de grandeur de nature morale comme chez les premiers, ou entre des volontés de puissance définies par les seuls statuts interactionnels comme chez les seconds, mais surtout entre des attentes et des motifs d’action appréhendés en termes de dispositions et d’enjeux en quête de sanction. Ce cadre d’analyse centré sur les conditions, les acteurs et les techniques de la performance musicale publique m’a permis d’approfondir trois séries de questions classiques en combinant diverses méthodes. Le principal matériel est constitué, pour les deux premières parties notamment, par un vaste corpus de commentaires publics du jazz (articles, ouvrages), et pour la troisième, par les séries d’observations de performances, d’analyses d’insertion participante dans des réseaux d’interconnaissance et d’entretiens semi-directifs (39) produites lors de terrains ethnographiques centrés sur les activités de deux jazz-clubs à Marseille et à Montreuil (1998-2001). D’autres méthodes sont néanmoins mobilisées en fonction des besoins de l’analyse : l’analyse quantifiée de réseaux de coopération ou d’espaces de polarisation (le champ du jazz en 1951, l’espace national des jazz-clubs en 1982 et 1997, le champ marseillais du jazz en 1988-1990, la programmation d’un jazz-club francilien de 1991 à 2001), l’analyse d’images fixes et animées de performances (autour du cake-walk dans les années 1910, et du jazz-club dans les années 1950-60), l’analyse des techniques et résultats d’analyses musicologiques sur partitions (années 1920 et années 1940), l’analyse d’archives organisationnelles (listings de membres, comptabilités, comptes rendus d’activités…). La première partie pose ainsi la question de la formation et de l’unité d’un genre artistique. Elle est abordée à travers l’analyse de la genèse d’une prise esthétique inédite et des réinvestissements dont elle est l’objet entre 1902 et 1939. La notion de prise a été traduite en outil sociologique, depuis la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, par Christian Bessy et Francis Chateauraynaud (1995). Jean-Louis Fabiani (2006) propose, sous l’expression de « prise multiple », de lui faire prendre en charge la plurivocité des significations disponibles qui résulte de la rencontre entre des trajectoires d’objets et leurs contextes d’appréhension. L’un des principaux résultats consiste ainsi à mettre au jour la prise multiple du rythme (afro-)américain, qui informe l’histoire du jazz (et probablement de quelques autres pratiques) jusqu’aujourd’hui. Sa particularité consiste à doter une catégorie sonore (le rythme contrapuntique de la syncope systématisée) d’une puissance d’évocation qui articule des enjeux sociaux (le renouvellement d’un hédonisme bourgeois), sexuels (la transformation des normes de sexualité juvéniles et bourgeoises) et nationaux (la définition métonymique de la culture française à partir des productions symboliques des professionnels de la culture, autour notamment du thème de l’américanisation culturelle), en termes essentiellement raciaux (l’imagerie assignée aux « nègres », avec ses rémanences et ses transformations) – sur la notion de race, et ses articulations avec les rapports de classe et de sexe, voir : Balibar & Wallerstein (1988), Fournier & Lamont (1992), Fassin & Fassin (2006), Dorlin (2006). La formation du genre musical jazz au tournant des années 1930 fixe en quelque sorte cette prise autour de la valorisation primitiviste (« nègre ») du rythme pulsé (i.e. syncopé et « pulsionnel », voire érotique). Ceci permet notamment de résoudre les difficultés posées par les approches des genres en termes de classification ou d’institutions, tout en les intégrant à l’enquête. Un genre artistique est défini comme une configuration stabilisée d’interdépendance entre, d’une part, des classifications cognitives et matérielles (des corpus) qui délimitent un répertoire de produits, un panthéon de producteurs et un canon de règles de production, d’autre part, un ensemble d’institutions relativement indépendantes (susceptibles d’agir en fonction de catégories en partie auto-déterminées, voire de les imposer) qui utilisent et prescrivent ces classifications traduites sous formes d’habiletés, voire de compétences, et de grilles d’appréciation (instances de consécration, circuits de valorisation, corps de producteurs spécialisés), et enfin, plusieurs formes spécifiques d’expériences attachées à des dispositifs d’appréciation stabilisés, dont la fabrication et la félicité constituent l’horizon régulateur des activités qui contribuent à la production et la reproduction du genre en question. Cette extension du questionnement permet ainsi de mettre en avant des contextes explicatifs rarement mobilisés pour rendre compte de l’invention et de la transformation des pratiques culturelles. Il s’agit notamment de donner toute leur place explicative aux spécificités du cadre spectatoriel music-hall tel qu’il apparaît à la fin du 19e siècle, et aux modes d’appropriation des technologies discographiques à partir des années 1920 tels qu’étudiés par Sophie Maisonneuve (2003). Cette approche conduit alors à reconsidérer les périodisations pertinentes. L’enquête ne débute pas avec l’apparition du terme jazz (aux alentours de 1917), cette approche nominaliste extrême tendant à réduire l’historicité à la succession de vocables d’époque, et à s’interdire ainsi de repérer quels sont les vocables performatifs, appuyés sur des institutions et des pratiques consistantes. Elle ne débute pas non plus avec la stabilisation d’un code sonore, option musicologique qui prête le flanc à l’anachronisme dès lors que ne sont pas interrogées les relations réellement entretenues par les agents avec les conventions musicales. L’enquête ne débute pas enfin avec la création de la première association de programmation spécialisée (le Hot Club de France) en 1932 : si celle-ci marque bien une rupture décisive, on ne la comprend pas sans restituer l’ensemble des pratiques sédimentées qui la rendent possible et qui donnent toute sa puissance d’évocation au genre musical dont elle se fait la spécialiste. Il s’agit donc de remonter à la commercialisation de la danse cake-walk en 1902, soit au moment où la prise multiple du rythme (afro-)américain est inventée. Ce moment cake-walk (1902) est d’abord situé par rapport à l’émergence du secteur des spectacles de variétés et du music-hall, et ainsi contextualisé au sein de trois séries qu’il vient entrecroiser : l’accès du marché étasunien des musiques populaires au leadership du marché international, l’intégration du music-hall et de la danse sociale au sein d’un même circuit de valorisation (le cake-walk étant simultanément une danse de bal et une danse de scène), et les transformations des imageries coloniales attachées aux « nègres ». L’élaboration de la prise du rythme (afro-)américain réalisée pour commercialiser le cake-walk est ensuite décrite comme la cristallisation d’enjeux raciaux, sexuels et sociaux autour du rythme « syncopé » et de la gestuelle « fantaisiste ». Le moment jazz band (1917) est quant à lui situé par rapport à la structure d’opportunités instaurée par la guerre, et particulièrement par la présence des troupes coloniales et surtout étasuniennes sur le sol métropolitain – soit le renouvellement des imageries ethno-raciales, et l’apparition d’un nouveau créneau marchand, les « attractions américaines ». L’utilisation démultipliée du jazz-band, format orchestral, conduit alors au réinvestissement de la prise du rythme (afro-)américain : elle est mobilisée pour définir un nouveau format de music-hall, la revue à grand spectacle, et constituée comme un marqueur moderniste par les avant-gardes (autour du format du ballet d’avant-garde et du primitivisme lettré) et par les fractions sociales aisées qui redéfinissent leurs contours autour de l’usage des loisirs publics (avec notamment le dancing et le spectacle). Les analyses et controverses savantes qui s’ensuivent contribuent à fixer un canon musical autour du jazz-band, tandis qu’au music-hall, ce dernier se voit différencié, selon une logique d’authenticité raciale, en un jazz nègre et un jazz blanc. Ceci signe une esthétisation du jazz-band, puisqu’il monte sur scène pour faire le spectacle et plus seulement l’accompagner, et ouvre alors un espace de spécialisation professionnelle aux musiciens de bal et de spectacle les mieux dotés. Avec le moment jazz hot (1928), la prise du rythme (afro-)américain est réinvestie à travers la pratique discophile et l’apparition d’une critique spécialisée, qui définissent peu à peu des positions de « passeurs » : grâce à la technologique discographique et à la distance temporelle et géographique qu’elle permet entre la prestation musicienne et l’écoute, il s’agit désormais de puiser à une source d’autant plus authentique qu’elle est lointaine – et de contrôler cette source. C’est en s’alliant puis en s’opposant aux musiciens de jazz-band spécialisés dans le « chorus hot » (soit des statuts valorisés de solistes improvisateurs virtuoses) que certains de ces « passeurs », jeunes lettrés en ascension ou déclassés, en viennent à constituer un genre musical. Les classifications et les institutions spécifiques qu’ils élaborent à partir de leur amateurisme discophile servent en effet dans un premier temps le positionnement des musiciens spécialisés au sommet du marché des variétés. Mais rapidement, il apparaît que la hiérarchie ethno-raciale promue par ces nouveaux intermédiaires esthètes situe les musiciens français et blancs loin derrière les musiciens étasuniens et noirs. Elle valorise qui plus est une forme d’expérience « artistique » peu adaptée au marché des bals et des spectacles d’où les musiciens professionnels tirent l’essentiel de leurs revenus. C’est ainsi seulement durant la Deuxième guerre mondiale que ces derniers renoueront avec le réseau institutionnel construit peu à peu par les intermédiaires du jazz hot : le Hot Club de France (1932) et sa fédération des « hot clubs » provinciaux, la revue Jazz Hot créée (1935), l’orchestre vedette du HCF avec Django Reinhardt et Stéphane Grapelly (1934), le label discographique Swing (1936), un local de répétition et d’écoute de disques (1939). La deuxième partie prolonge ce questionnement sur la stabilisation des pratiques en interrogeant la formation, à partir du genre musical « jazz », d’un champ social spécifique. Il s’agit ici de reconsidérer l’analyse en termes de « magie sociale » des homologies structurales, car elle tend à faire l’impasse sur l’ensemble des médiations processuelles qui coproduisent des corpus d’œuvres, des institutions et des publics ajustés les uns aux autres (Hennion 2003). L’enquête désynchronise ainsi les trois processus recouverts par la notion d’autonomisation (la spécialisation des producteurs, la formation d’un marché spécifique et l’autonomisation des instances de consécration) en y ajoutant deux autres rarement traités d’un même tenant : la captation et la disqualification des amateurs par l’élaboration de formes d’expérience musiciennes (autour du style bebop dans les années 1950) puis formalistes (autour du style free jazz dans les années 1960-1970), et la domestication des audiences avec l’invention des dispositifs jazz-club, concert de jazz puis jazz action. Le renouvellement du marché des variétés est ainsi impulsé durant l’Occupation par l’industrie discographique, à travers la vogue « juvénile » des chansons et des orchestres « swing » que parvient à capter en partie le HCF : il devient l’un des principaux impresarios, tourneurs, producteurs, promoteurs des musiciens spécialisés, et s’allie une nouvelle génération musicienne grâce au succès des tournois d’orchestres amateurs. A la Libération, l’élaboration et la prescription d’une forme musicienne d’expérience (le jazz comme « langage musical ») s’appuient conjointement sur la réception du style bebop, présenté comme savant, et sur la médiatisation des « caves de Saint-Germain-des-Prés » (i.e. des sociabilités d’écuries éditoriales). Les concurrences qui s’ensuivent entraînent la différenciation de deux pôles, l’un « traditionnel » et l’autre « moderne », qui marque la stabilisation du champ du jazz avec l’invention des dispositifs jazz-club et concert de jazz, soit la domestication des audiences. Au tournant des années 1960, les entrants sur le marché des musiciens et des journalistes sont soumis à une double contrainte : outsiders vis-à-vis de leurs aînés établis, et pris comme ces derniers entre l’investissement soudain du marché français par les agents dominants du marché étasunien (qui se traduit par la commercialisation simultanée de trois nouveaux styles : hard bop, jazz modal et free jazz), et la fuite des principaux intermédiaires vers le marché en expansion des variétés juvéniles (rock et yéyé). L’élaboration et la politisation d’une forme formaliste d’expérience, appuyée sur l’offre théorique « structuraliste » et sur le modèle de singularité artistique des arts contemporains, ouvre alors une voie de contournement, avec la construction d’une avant-garde légitime puis son insertion dans les réseaux décentralisés d’action culturelle mis en place dans le sillage de la crise socio-politique de 1968. La définition du dispositif jazz action et de la catégorie des musiques improvisées européennes permet, en liant l’avant-garde aux prémisses de l’économie culturelle subventionnée, la création d’un marché alternatif à la concentration parisienne des positions établies ainsi qu’à la domination du marché étasunien. L’enquête permet ainsi la formulation de réponses plus précises aux deux questions sociologiques qui organisent l’analyse. D’une part, la constitution du genre puis du champ du jazz est située dans un contexte international, c’est-à-dire en rapport avec la domination relative du marché étasunien. De ce point de vue, l’analogie avec la littérature permet de faire l’hypothèse que le champ français du jazz peut être décrit comme un champ périphérique qui s’autonomise en s’appuyant sur le pôle « puriste » du champ central (étasunien) – c’est l’analyse proposée par Pascale Casanova (1999) à propos de la littérature. Mais le jazz étant défini comme un genre à la fois américain et instrumental (et non chansonnier), ses agents ne peuvent pas s’appuyer sur la barrière linguistique pour étendre leur contrôle sur les flux d’importation des œuvres et des musiciens. Ce facteur est notamment décisif pour comprendre les modalités très différentes de la réception du bebop puis du free jazz. En effet, si l’absence de barrière linguistique empêche les intermédiaires de capter les flux d’importations pour s’en faire les passages obligés (les traducteurs), ils sont exposés directement aux aléas des stratégies des exportateurs étasuniens (ils ne peuvent prétendre qu’au statut de « passeurs »). Dès lors, leur position dépend presque exclusivement de l’intérêt que les exportateurs dominants portent au marché français, et qui se traduit essentiellement en termes de temporalité. Lorsque ces derniers sont en retrait, les intermédiaires français ont le temps de capter les produits exportés par des agents dominés du marché étasunien (en l’occurrence, le bebop), et ainsi de construire des positions internationalement dominées, mais nationalement dominantes – soit de former un champ spécifique. A l’inverse, lorsque l’offre du marché étasunien est exportée massivement et directement sur le marché français, ces positions établies se voient court-circuitées et dévaluées – et contraignent les entrants sur le marché à des stratégies de contournement, soit en l’occurrence à la constitution du free jazz en avant-garde politisée. D’autre part, le champ du jazz est aussi situé dans le champ musical (français). A cet égard, la définition habituelle du jazz comme un « art moyen », comme le seraient la photographie (Bourdieu et al 1970) ou la bande dessinée (Boltanski 1975), ne permet pas de tenir compte du fait qu’il est d’emblée appréhendé, en France, comme une forme d’expérience lettrée. Son illégitimité relative vis-à-vis des musiques académiques, et sa démarcation continuée d’avec les musiques populaires l’apparentent plus spécifiquement à une « culture libre » (définie par opposition à la culture scolaire). Cette hypothèse conduit alors à revenir sur la question de l’évolution et de la pluralité de la culture lettrée. Emmanuel Pedler (2003) rappelle en effet que le goût pour les arts savants est très minoritaire au sein de la bourgeoisie, y compris culturelle, même s’ils y sont un peu plus fréquentés que dans les autres classes sociales. On peut se demander en effet si son histoire n’est pas structurée par l’opposition entre deux éthiques de loisir, ascétique et hédoniste (Weber 1975), continûment réinvesties et spécifiées en fonction des ressources que leurs promoteurs respectifs parviennent à mobiliser – et si la domination relative de l’ascétisme pourrait n’avoir été qu’une sorte de parenthèse historique. Du fait de l’ambiguïté de sa place culturelle, le jazz constitue de ce point de vue une sorte de plaque sensible. Qui plus est, en répondant à ces questions, quelques éléments d’explication sur la genèse d’un décalage structural rémanent sont livrés. En effet, les intermédiaires qui produisent l’autonomie du champ du jazz, dans les années 1950, en rapport essentiellement avec les musiques académiques (reprenant leur forme savante et musicienne, et leur opposant l’hédonisme du rythme pulsé) finissent par fuir le jazz au tournant des années 1960 pour investir le secteur des variétés. De leur côté, les jazzmen qui s’appuient sur les formes d’expérience prescrites par les précédents pour définir des statuts d’artistes trouvent l’essentiel de leurs emplois dans les studios, les spectacles et les galas de variétés. Il faut ainsi mettre cette structuration du champ du jazz en lien avec le statut singulier du genre dans les reconfigurations récentes de la culture lettrée et du marché musical. D’un côté, Philippe Coulangeon a souligné comment le jazz joue un rôle-pivot dans la « montée de l’éclectisme cultivé », servant simultanément d’alternative « moderne » vis-à-vis de la banalisation de la musique classique et de la marginalisation de la musique contemporaine, et d’élévation culturelle vis-à-vis du rock ou d’autres genres populaires (Coulangeon 2003, 2004 ; Peterson & Simkus 1992 ; Peterson & Kern 1996). De l’autre côté, les jazzmen constituent une sorte d’élite du marché des musiques non académiques. Dans cet espace où les classifications génériques imposées par les intermédiaires sont loin d’être étanches, ce sont en effet les musiciens qui se définissent comme jazzmen qui sont en réalité les plus polyvalents. Cette situation contemporaine remonte de fait aux années 1920, et l’enquête en propose ainsi la généalogie : les formes d’expériences prescrites et les dispositifs d’appréciation stabilisés par les intermédiaires ont produit et renouvelé cette place à la fois marché marginale et cardinale du jazz au sein de la culture lettrée et du champ musical. Avec la troisième partie, la question des échelles de l’expérience est traitée de façon plus directe, en exploitant les possibilités de l’analyse ethnographique – puisqu’il s’agit cette fois de pratiques contemporaines de l’enquête – pour associer approche historique, ressources quantitatives et microanalyses. L’enjeu est de se garder de décrire cette « traduction d’échelles » sur le modèle de contextes emboîtés (chaque niveau définissant un cadre ou une simple interface pour le niveau « plus petit »), mais bien de montrer que les différents enjeux mis au jour, y compris les plus macrosociologiques, sont acheminés et font sens au sein même des formes d’expérience à l’œuvre lors des interactions spécifiques à chaque jazz-club étudié. Cette partie s’ouvre sur l’analyse d’une nouvelle structure d’opportunités apparue au tournant des années 1980. La mise en place d’une politique du jazz à partir de 1982 s’appuie ainsi essentiellement sur les réseaux de musiciens et d’intermédiaires constitués autour des musiques improvisées dans la décennie précédente. Elle a pour effets principaux de consacrer cette avant-garde en l’intégrant au secteur du marché subventionné, et d’insérer le jazz au sein des institutions pédagogiques savantes, ouvrant aux musiciens les revenus d’appoint de l’enseignement et favorisant les compétences musiciennes élaborées par la pratique des partitions (souci de la construction formelle et de la complexité harmonique, essentiellement). Au même moment, l’internationalisation et la concentration des industries musicales, accélérées par la mise sur le marché des techniques numériques (disque compact), engage des stratégies de réédition massive des fonds de catalogues : les musiciens vivants sont alors soumis à une sorte de concurrence inégale qui voit 90 % des productions discographiques réservées aux musiciens du passé. Le processus conséquent de segmentation du champ entre un « circuit marchand des jazz-clubs » et un « circuit subventionné des concerts et festivals » s’accompagne ainsi de l’imposition de formes patrimoniale et créative d’expérience du jazz. L’élaboration et la prescription de la forme patrimoniale d’expérience du jazz, ainsi que la réinvention du jazz-club, sont interprétées comme des façons de reprendre pied sur le marché pour les laissés-pour-compte de la consécration étatique et de la redistribution du panthéon discographique. Il s’agit alors de montrer comment ces processus macrosociologiques sont retraduits dans l’espace marseillais du jazz, soit la façon dont l’invention d’une tradition locale, au tournant des années 1990, repose conjointement sur la mémoire d’un « âge d’or » situé dans les années 1950, et sur la possibilité qu’ouvrent les transformations de la configuration locale pour remobiliser les réseaux d’interconnaissance professionnelle qui en sont issus. Ces résultats sont enfin exploités pour faire sens des interactions observées dans un jazz-club marseillais, le Pelle-Mêle, et décrire la fabrication « au second degré » d’expériences du jazz : la forme patrimoniale d’expérience définit le jazz comme un stock de procédés d’improvisation inventés par les maîtres du jazz des années 1940 à 1960, et réutilisés par les musiciens actuels ; il s’agit d’écouter conjointement l’œuvre en train de se faire et l’hommage qu’elle rend au génie des anciens. Le même type d’articulation d’échelles est proposé pour analyser l’invention d’une « scène musicale » inédite, celle des musiques improvisées radicalisées, autour du jazz-club montreuillois Instants Chavirés. Ses stratégies de programmation, ancrées quant à eux dans les circuits de l’économie subventionnée, le conduisent en effet de l’investissement de l’avant-garde consacrée à la construction d’une « jeune avant-garde », qui définit l’improvisation non plus comme un critère de définition du jazz, mais comme une technique musicienne vouée à la subversion des catégories génériques. La forme d’expérience élaborée est alors centrée sur la coordination sur le vif d’individualités esthétiques, dont les styles sont puisés tout autant dans les procédés du jazz que dans ceux de la musique contemporaine, du rock alternatif ou des musiques électroniques. Ce processus est rapporté en partie à la mise en place d’une politique publique des « petits lieux » dédiée aux « musiques actuelles », soit une sorte de certification catégoriale de l’éclectisme cultivé des jeunes générations scolarisées. L’enquête s’achève enfin sur la description des activités d’une association issue de cette « scène », consacrée à l’expérimentation avant-gardiste de l’expérience de l’improvisation, et montre comment les enjeux professionnels investis par les participants, définis par rapport à leurs trajectoires et à leurs positions dans le champ, sont mis à l’épreuve des effets incertains des déroulements d’interactions. Cette notion d’épreuve permet en effet de décrire précisément comment s’imbriquent, dans l’enchaînement des situations, les facteurs structuraux et la logique propre de l’ordre interactionnel. Balibar Étienne, Wallerstein Immanuel, 1988, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte. Bessy Christian, Chateauraynaud Francis (dir.), 1995, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, Paris, Métailié. Boltanski Luc, 1975, « La constitution du champ de la bande dessinée », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°1, p. 37-59. Boltanski Luc, Thévenot Laurent, 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard. Bourdieu Pierre, Boltanski Luc, Chamboredon Jean-Claude, Castel Robert, 1970, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit. Casanova Pascale, 1999, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil. Coulangeon Philippe, 2003, « La stratification sociale des goûts musicaux. Le modèle de la légitimité culturelle en question », Revue Française de Sociologie, vol. 44, n°1, p. 3-33. Coulangeon Philippe, 2004, « Classes sociales, pratiques culturelles et styles de vie. Le modèle de la distinction est-il (vraiment) obsolète ? », Sociologie et Sociétés, vol. 36, n°1, p. 59-85. Dewey John, 1980 [1934], Art as Experience, New York, Perigee Books. Dorlin Elsa, 2006, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris, La Découverte, coll. « Genre & sexualité ». Fabiani Jean-Louis, 2006, Beautés du Sud. La Provence à l’épreuve des jugements de goût, Paris, L’Harmattan, coll. « Anthropologie du monde occidental ». Fassin Didier, Fassin Eric, 2006, De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte. Foucault Michel, 1994 [1976], Histoire de la sexualité. I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, coll. « Tel », notamment p. 101-135. Fournier Marcel, Lamont Michele (eds.), 1992, Cultivating[...]
Bien que les études relatives au Viêtnam soient, à leur début, étroitement liées à la colonisation, elles ne sont cependant pas le fait exclusif des orientalistes français. Toutefois, si les lettrés viêtnamiens ont produit dans le passé des connaissances sur le pays (recueils de lois, traités de géographie et d'histoire, etc.), c'est dans la 1ère moitié du XXe siècle qu'a lieu, en raison du fait colonial, une réflexion systématique sur l'homme en société et sur l'altérité. Les écrits épisodiques laissent la place à des projets cohérents notamment autour de revues. L'Ecole Française d'Extrême-Orient qui assumait dans le contexte colonial un pôle d’excellence devient pour les Vietnamiens l’enjeu social et symbolique d’une lutte pour la conquête du pouvoir scientifique : le statut d'assistant leur est acquis en 1929, et celui de membre scientifique en 1939. Nguyễn Văn Huyên représente dans cette ascension une figure typique : tout en intégrant dans le champ orientaliste, ses textes sont orientés par les enjeux de l'identité viêtnamienne. Au Viêtnam, l'anthropologie est née ainsi au confluent des traditions intellectuelles de la France, du Viêtnam et de la Chine. Mots-clés : Viêtnam, études viêtnamiennes, orientalisme, EFEO, identité, altérité, champ, discours, anthropologie, socio-histoire des intellectuels
Originaires de Pavie, Antonio Guaineri (v.1390-1458) et son fils Théodore (1449-v.1509) connurent tous deux une riche carrière médicale. Physicien d’Amédée VIII de Savoie puis de Jean-Jacques de Montferrat pour le premier, au service des rois de France Charles VIII et Louis XII pour le second, ils incarnent l’émergence du médecin de cour. La lecture croisée de leur bibliothèque personnelle et de leurs propres œuvres permet de mettre en évidence la dimension pratique de leur médecine, qui fait dialoguer autorités scientifiques et expérience personnelle. En outre, l’étude des cas médicaux décrits dans leurs traités offre un regard nouveau sur la relation thérapeutique au XVe siècle. Enfin, loin de se limiter au seul médecin, leurs écrits accordent une place aux autres acteurs du soin – qu’ils soient reconnus dans l’exercice de leur art, ou que leurs pratiques se déploient en marge de la médecine institutionnelle.
Dans l’immense catalogue des travaux consacrés à l’étude des chemins de fer, cette thèse prétend à une certaine originalité en abordant la question des fonctions et des usages de la comptabilité ferroviaire. Cette question s’inscrit dans un cadre plus global d’étude des pratiques comptables des entreprises de réseau. Appliquée aux compagnies de chemin de fer des origines à 1937, notre étude a pour ambition d’identifier les facteurs de contingence et d’évolution de la comptabilité ferroviaire. À ce dessein, nous avons mobilisé les travaux de Flichy pour dépasser le déterminisme des principaux paradigmes en histoire de la comptabilité. Les résultats de cette étude montrent que les fonctions explicites de la comptabilité ne correspondent pas souvent à ses usages sociaux. Des facteurs de contingence sont identifiés pour expliquer la divergence des usages de la comptabilité par les différents acteurs du secteur ferroviaire. Cette étude a permis également d’identifier trois régimes majeurs dans l’évolution des savoirs théoriques et pratiques en matière de comptabilité ferroviaire. Le premier régime de la pratique (1817-1842) est caractérisé par la diversité des pratiques comptables et l’inexistence d’un savoir théorique structuré. Le deuxième régime de la technique (1842-1883) est caractérisé par des phénomènes de mimétismes et de recherche de la meilleure méthode comptable. Enfin, le troisième régime de la technologie (1883-1937) se caractérise par une rigueur méthodologique et scientifique, notamment à travers l’introduction de la formation et l’enseignement, dans l’élaboration des règles comptables.
L’objectif de cette recherche est de caractériser les aspects topographiques, fonctionnels et architecturaux de l’abbaye bénédictine de Cormery établie en Touraine, par la communauté de Saint-Martin de Tours, en 791 et restée en fonction jusqu’à la Révolution française. Cette approche multi-scalaire du monastère s’appuie sur les sources textuelles et les nombreux vestiges en élévation qui incluent les bâtiments claustraux. La première partie de ce travail s’attache à analyser le contexte de fondation du monastère dans la vallée de l’Indre et tout particulièrement le lien avec la rivière. Dans un deuxième temps, une étude archéologique a été menée sur les vestiges de l’église abbatiale et de la tour-clocher de l’époque romane à partir de relevés réalisés en lasergrammétrie et photogrammétrie. Enfin, l’analyse de l’organisation spatiale de l’établissement monastique et de sa périphérie où s’est formé un bourg conclut ce travail.
Au XIX e siècle, l’impuissance sexuelle est une cause de nullité de mariage en Espagne. Ce travail repose sur sur l’analyse de 61 d’entre elles instruites par les tribunaux diocésains de Madrid et Saragosse entre 1777 et 1919 et d’un corpus de sources médicales, juridiques, littéraires et érotiques. À la fin du XVIII e siècle, l’impuissance est définie comme toute incapacité physique ou morale empêchant de pratiquer le coït, et peut donc concerner des femmes. Son traitement juridique et médical traduit la volonté de l’Église d’encourager la procréation et d’éviter les pratiques sexuelles immorales. À partir des années 1840, les savoirs sur la sexualité reproductive se transforment considérablement, donnant naissance à la fin du siècle à une « proto-sexologie » qui bouleverse les savoirs sur l’impuissance. Alors qu’au début du siècle ni le mot ni le concept de sexualité n’existent, à la fin du siècle ces nouveaux savoirs, l’approfondissement de la binarité de genre et l’émergence de la notion d’identité sexuelle en font une pathologie masculine interprétée comme le signe d’une virilité défaillante. Autour d’elle se concentrent alors des angoisses consécutives au « Désastre » de 1898 : celles d’une décadence et d’une dégénérescence de l’Espagne autrefois si puissante, qui aurait perdu sa virilité avec l’entrée dans la modernité.
La question de la scientificité de la psychanalyse a fait l'objet de nombreux débats ces dernières décennies. Le fait de poser une telle question soulève toutefois un double problème : d'abord, la définition de la science varie suivant les époques et les disciplines, ensuite, cette définition est un enjeu de luttes au sein du champ scientifique. Dans ce travail, plutôt que de tenter d'y répondre, nous analysons les représentations de la science et de ses rapports avec la psychanalyse chez deux analystes, Freud et Lacan, à l'aide de l'épistémologie historique et de la sociologie bourdieusienne du champ scientifique. Nous étudions d'abord les critiques portant sur la scientificité, l'efficacité et le rapport à l'histoire de la psychanalyse, puis la façon dont les psychanalystes se sont situés par rapport à ces critiques. Nous examinons ensuite les représentations de la science chez Freud, représentations marquées par le climat positiviste qui dominait les pays germanophones au tournant du XXe siècle. Nous abordons enfin les travaux de Lacan, qui a développé une approche critique interrogeant la nature du savoir scientifique d'un point de vue psychanalytique. L'analyse des représentations freudiennes et lacaniennes de la science permet de formuler plusieurs propositions propres à nourrir l'épistémologie de la psychanalyse.
Notre thèse présente une approche sociale et environnementale de l'histoire des cyclones dans la société réunionnaise : il s'agit d'évaluer l'impact d'un événement destructeur, le cyclone, dans la mémoire collective et individuelle, dans l'évolution des sciences, des techniques, des alertes, de la gestion de la crise, de l'organisation des secours et de l'aménagement du territoire. Le cyclone peut donc être un objet d'Histoire à part entière. Parallèlement, notre recherche consiste à comprendre les conséquences des cyclones d'un point de vue géographique et humain. L'impact des cyclones est différent selon le lieu frappé et l'habitat ainsi que de leur évolution dans le temps. Par ailleurs, l'histoire des comportements humains apporte d'autres éléments à l'enquête avancée : la solidarité intègre cette région du monde dans un contexte national et international par l'aide sollicitée auprès de la métropole et d'autres pays. Les autorités et les services compétents entrent en compte pour l'administration de l'île et les choix à faire tant en terme de prévention, que d'information et de mobilisation. Parmi les cyclones marquants du XXème siècle, le cyclone des 26 et 27 janvier 1948 est communément appelé « le cyclone du siècle ». Cependant, le cyclone Jenny (28 février 1962), par ses apports, semble être le point de départ d'un demi-siècle de mutations. Et de fait, une césure dans l'histoire de la société réunionnaise. L'objectif final de notre recherche est de contribuer au progrès d'une prise de conscience collective des cyclones afin de mieux limiter les dégâts humains et matériels lors de leurs passages.
|